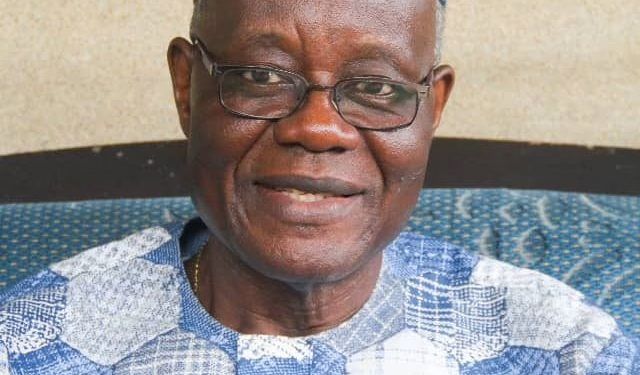OSONS LE DIRE
RÉVISION DE LA CONSTITUTION : L’ENJEU DE LA PROMULGATION
À la veille de la promulgation de la loi portant révision de la constitution au Bénin, une dynamique d’explication est entreprise par plusieurs acteurs de haut rang de la mouvance présidentielle.
Elle vise à instaurer un cadre d’intelligibilité autour des innovations proposées. Cette démarche, bien qu’indispensable, ne dissipe pas entièrement les interrogations de fond qui accompagnent toute transformation normative touchant à l’architecture de l’État.
Un premier registre de questionnement porte sur le principe d’applicabilité temporelle des normes constitutionnelles révisées.
La problématique consiste à déterminer si les nouvelles dispositions sont susceptibles de produire des effets immédiats sur le mandat en cours du chef de l’État.
Cette interrogation recouvre la dialectique classique entre non-rétroactivité des normes et continuité institutionnelle, deux principes cardinaux qui soutiennent la stabilité d’un ordre constitutionnel.
Le second axe d’analyse concerne l’impact potentiel de la révision sur la configuration du processus présidentiel de 2026.
Les duos déjà engagés dans les démarches pré-électorales s’inscrivent dans un environnement juridique en mutation.
Dès lors, la question de la sécurité normative se pose : les critères d’éligibilité, les modalités de parrainage ou encore les conditions d’accès au scrutin doivent être clairement définis pour éviter tout déficit de prévisibilité institutionnelle, essentiel au fonctionnement régulier de la démocratie.
Le troisième élément de débat se concentre sur la création d’une seconde chambre, le Sénat, telle que prévue par la réforme. Ici, les discussions dépassent la simple terminologie, certains suggérant l’appellation Haut Conseil des Sages pour s’orienter vers une interrogation plus substantielle sur la nature, la vocation et la légitimité de l’institution.
Le Sénat ne saurait être réduit à une innovation terminologique : il s’agit d’un nouvel acteur au sein du système de gouvernance, dont les missions et la composition nécessitent une réflexion fine sur leur cohérence interne et leur compatibilité avec la structure existante.
Une quatrième interrogation mobilise la question de l’articulation organique des compétences. La crainte d’une surenchère de prérogatives attribuées au Sénat, pouvant empiéter sur les missions des institutions judiciaire, législative ou de régulation, appelle une analyse systémique.
Toute réforme institutionnelle doit éviter la fragmentation des pouvoirs et préserver le principe d’équilibre, sans lequel la fonctionnalité du système constitutionnel s’effrite.
Dans ce contexte, une problématique transversale se détache : celle de la fédération des postures.
Comment construire l’adhésion autour d’une réforme majeure dans un contexte de pluralité des perceptions et d’hétérogénéité des intérêts ?
Cette question engage la capacité de l’État et des acteurs politiques à mobiliser une pédagogie institutionnelle inclusive, à garantir une transparence argumentative et à favoriser une appropriation collective des objectifs poursuivis.
La promulgation de la révision constitutionnelle ne saurait être appréhendée comme un acte purement formel.
Elle représente un moment de cristallisation normative, dont la portée politique, juridique et symbolique est déterminante.
Sa réussite dépendra de la capacité à instaurer un cadre d’interprétation partagé, fondé sur la rationalité juridique, la cohérence systémique et l’impératif supérieur de cohésion nationale.
DISTEL AMOUSSOU