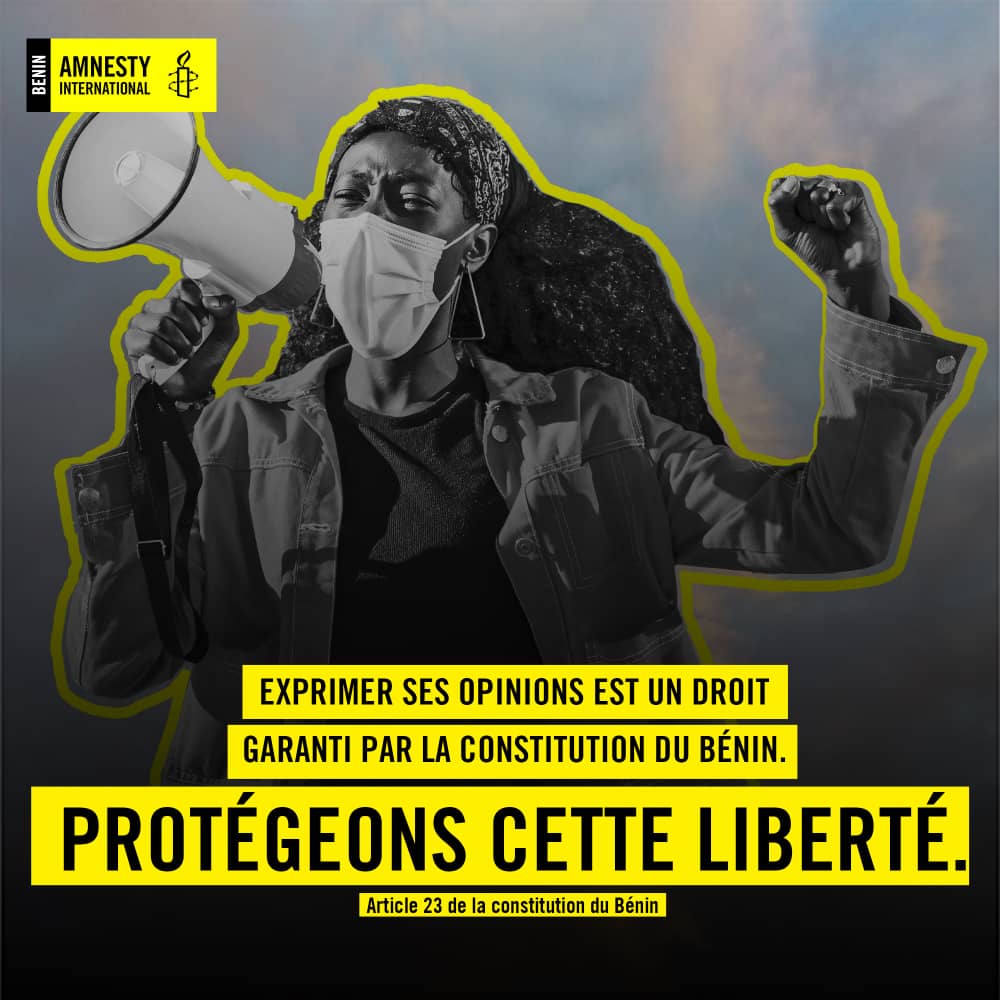« Ce n’est pas l’asphaltage on va manger », « L’asphaltage n’est pas synonyme de développement » ! Deux assertions auxquelles les oreilles des béninois ont été habituées depuis quelque temps et qui rappellent d’une certaine manière une autre vieille d’un peu plus de 30 ans datant du mandat du Président Nicéphore Soglo à savoir « Est-ce les voies pavées qu’on va manger/Pavé mi an dou a ? ». C’est par ces énonciations sur l’action publique que je voudrais aborder ce qu’il conviendrait d’appeler ‘’déni de l’innovation dans l’action publique’’.
Le pavage des voies qui a pris une ampleur particulière entre 1991 et 1996 avec le Président Nicéphore Soglo et l’asphaltage au sens de « action d’appliquer un revêtement d’asphalte sur une surface, généralement une chaussée ou un trottoir » avec le Président Patrice Talon près de 30 ans plus tard apparaissent en effet comme étant des innovations en matière d’action publique en République du Bénin. Si à l’instar du pavage, l’asphaltage fait l’objet de discours noircissants de la part d’une certaine catégorie d’acteurs politiques, on note actuellement une certaine inflexion dans le discours ‘’médisant’’ de l’action publique : du déni au départ, ce discours semble glisser légèrement. Contrairement au passé, certaines critiques de l’asphaltage mettent plus à présent l’accent sur le fait qu’un Président de la République ou un Gouvernement n’a aucun mérite particulier en construisant des voies avec l’argent du contribuable qui a mandaté à cet effet.
En d’autres termes, d’après cette façon de voir, c’est comme si les ressources publiques nivellent la performance des gouvernements en matière d’action publique. Il aurait donc suffi de doter deux gouvernements des mêmes ressources dans un même contexte et le tour est joué : les résultats tombent automatiquement. Les choix stratégiques et la qualité de l’utilisation des ressources publiques ne compteraient donc pas.

Loin de moi l’idée de prendre une position dogmatique sur le sujet au risque de tomber dans le même piège que ceux qui diffusent une telle perspective. Je voudrais juste, sans prétention, attirer l’attention sur certaines limites de cette perspective dans le seul et unique but de contribuer à éclairer chacune et chacun de nous à construire sa propre opinion. On a beau faire de remettre les mêmes ingrédients (huile, épices, légumes, viande/poisson, etc.) à deux cuisiniers différents ; ces derniers ne produiront pas forcément la même qualité de sauce. Dans le même ordre d’idées, à partir de la quantité et qualité de sable, de ciment et d’eau, deux maçons ne produiront pas forcément la même qualité de crépissage sur une même superficie de mur. Je m’en voudrais de finir avec les exemples sans mentionner la célèbre parabole des talents dans Matthieu (25 : 14-30) où le maitre qui partait en voyage avait remis des biens à trois de ses serviteurs. Seuls deux ont fait preuve d’initiative et ont pu fructifier les biens à eux remis contrairement au 3ème serviteur.
Dans son œuvre « Les Damnés de la Terre », Frantz Fanon (1961) nous enseigne que « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. » L’orientation de l’action publique n’est jamais une donnée, la stratégie et les actions ne sont pas toujours évidentes sans oublier les risques d’inaction ou d’inefficacité dans l’action publique. Non seulement tout se conçoit et se construit, mais deux individus conçoivent et construisent rarement de la même manière, encore moins deux équipes. En clair, la qualité de l’action ne s’épuise pas dans la quantité des ressources. La touche individuelle, le savoir-faire du gestionnaire ou du dirigeant et de son équipe compte beaucoup, que l’on soit à l’échelle infranationale, nationale ou supranationale.

Venant donc de prescripteurs d’opinions que sont les acteurs publics ou de tout autre influenceur dans des contextes apparentés à celui du Bénin pour ne pas dire du monde en développement, le discours, sur le déni de l’innovation et de la qualité en matière d’action publique ou collective, reste potentiellement nuisible à la valorisation des talents, au travail bien fait, au nécessaire et indispensable souci de qualité des biens et services publics ou collectifs à délivrer. Toutes choses susceptibles de créer la confusion et la corruption des esprits des individus et surtout des jeunes qui constituent l’avenir du pays et à qui revient la responsabilité de tisser la nouvelle corde sur l’ancienne là où cette dernière est assez vertueuse. C’est une question de morale politique et de survie. Loin d’être inoffensifs, les discours, dans n’importe quel contexte, en tant qu’ensemble d’idées, de paroles, de symboles détiennent un pouvoir transformateur dont la portée dépasse le temps présent pour embrasser le futur proche et lointain.
Pour ma part, médire sur un succès ou une bonne pratique de l’autre reviendrait à juger injustement non seulement ce dernier, mais également tous les acteurs impliqués dans la chaîne de production dudit succès ou bonne pratique, une sorte d’ingratitude qui pourrait émousser des ardeurs, voire tuer des vocations. A cela, il faut ajouter les risques de réappropriation, de banalisation et de normalisation de l’acte de déni avec les effets potentiels pervers inhérents. C’est comme étouffer la lumière d’aujourd’hui qui aurait pu éclairer demain. En outre, une telle posture constitue un obstacle majeur au développement et à l’ancrage d’une culture des choix électoraux basés sur les projets de société et de la qualité des biens et services publics tant souhaité dans un contexte où d’après Léonard Wantchékon (2001), le clientélisme demeurait le principal critère de choix des électeurs avec néanmoins une plus grande sensibilité des femmes aux aspects programmatiques (qualité des politiques publiques).

Au regard des coûts socio-économiques et politiques associés au déni des succès ou des bonnes pratiques rappelées précédemment, on gagnerait à adopter de nouvelles postures plus encourageantes et favorables à l’innovation et à la reconnaissance du mérite en politique publique ou en action collective, condition sine qua non à l’enracinement d’une culture électorale et d’évaluation des gouvernants ou des responsables sur la base des choix stratégiques et de la qualité de leurs réalisations. En la matière, on gagnerait à la construction, à l’adoption de références sociétales, de balises communes ou de critères convergents d’appréciation de l’efficacité de l’action publique et du progrès afin d’aseptiser nos critiques de la frivolité. C’est une question de survie individuelle et collective.
Dr Ir Dossa AGUEMON
Agronome, Sociologue, Politiste
« Qui dénie une bonne œuvre court le risque d’offenser l’Esprit »
Porto-Novo, 09 octobre 2025