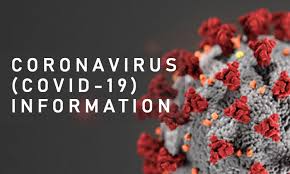Prix Nobel de littérature 1986, Wole Soyinka est connu comme dramaturge et poète. Après Les Interprètes (1965) et Une saison d’anomie (1973), il a publié en 2021 son troisième roman Chroniques du pays des gens les plus heureux du monde, désormais disponible en français. Inspiré par les dérives de la société nigériane, ce roman, raconte la corruption des élites dans une Afrique cherchant ses repères. Entretien avec Christiane Fioupou(1), angliciste et traductrice de Soyinka.
RFI : Christiane Fioupou, vous connaissez le Nigeria littéraire comme peu de gens le connaissent. Vous avez enseigné notamment l’œuvre de Soyinka à l’université, vous l’avez traduite. Quelle fut votre première impression en découvrant le nouvel opus du grand maître de la parole nigériane ?
Christiane Fioupou : J’ai été enthousiasmée par ce livre que j’ai lu d’abord en anglais. Les Chroniques du pays des gens les plus heureux du monde est un grand roman sur le Nigeria et sur l’état du monde, plus généralement. Il est foisonnant, bouillonnant, rythmé, dense. En raison de ses intrigues à rebondissements, il y a très peu de répit dans la narration. Ce livre est une sorte de thriller, une satire politique décapante, avec des personnages haut en couleur. Je suis impressionné par la maîtrise, l’art et la cohérence de la pensée de son auteur que je connais bien car je lis et étudie son œuvre depuis plusieurs décennies. Pour vous dire combien j’ai été favorablement impressionnée par ses Chroniques, une fois que j’ai eu fini ma lecture, je n’avais qu’une envie, celle de retourner à la première page pour me réjouir encore plus du texte lui-même et de la manière dont l’auteur aborde des thèmes si multiples, riches, voire incroyables, alternant humour et horreurs !
Pourtant les thèmes de la politique, la religion ou la corruption que Soyinka aborde dans ce nouveau roman, ne sont pas des sujets neufs. Ces thématiques traversent toute son œuvre…
En effet, le lien entre le politique et le religieux est une constante dans l’œuvre de Soyinka. D’ailleurs, l’un des premiers articles que j’ai écrits sur lui portait sur les « contorsions politico-religieuses » dans son théâtre. C’était au moment où Soyinka a reçu le prix Nobel en 1986. Son corpus comptait déjà plusieurs titres, textes littéraires, articles, essais, où il était question des dérives du pouvoir, de l’instrumentalisation du religieux par la classe politique pour mieux manipuler le peuple. Ce sont des sujets qui poursuivent l’écrivain depuis très longtemps, dès ses premiers textes. Je pense notamment à La Danse de la forêt, une pièce de théâtre qui lui avait été demandée à l’occasion des célébrations de l’indépendance du Nigeria en 1960. Soyinka a raconté dans une interview qu’en rentrant dans son pays, il s’était vite rendu compte que l’indépendance n’allait pas nécessairement coïncider avec progrès et développement qu’il était censé présenter dans cette pièce. Depuis, dit-il, « je n’ai cessé d’exprimer finalement la danse macabre de cette jungle politique » aime-t-il répéter. C’est cette danse macabre que l’on voit à l’œuvre dans son nouveau roman.
Ce nouveau roman est en fait le troisième roman de Soyinka en plus de soixante ans de carrière littéraire. L’homme est connu comme dramaturge, poète, essayiste. Pourquoi, à bientôt 90 ans, a-t-il ressenti le besoin de revenir au roman ?
Dans une interview qu’il a accordée quand le livre est sorti en anglais, Soyinka a expliqué que depuis plusieurs années il était taraudé par un certain nombre de sujets nés de son observation du monde, de ses drames et de ses tragédies. Il avait déjà traité ces sujets dans des sketchs, mais jamais dans le théâtre, ni dans la poésie qui n’ont pas l’ampleur du roman. A travers le roman qui n’est pas toutefois son genre préféré, il pouvait aborder la multiplicité de sujets qui le hantaient. C’est ce qu’il a fait dans Chroniques, mais comme le roman est une forme étonnamment flexible et s’adapte à toutes les sensibilités, on retrouve aussi dans ces pages, derrière la prose de la fiction, Soyinka le dramaturge, le poète, l’essayiste en colère contre les dérives du monde, mais aussi l’acteur et le chanteur que l’écrivain a incarné aux différents moments de sa vie.

Pourriez-vous en quelques phrases résumer l’intrigue ou les intrigues du roman pour que les internautes se rendent compte comment s’articulent les différents thèmes que l’auteur aborde dans ce livre de plus de 500 pages ?
Il est difficile de résumer ce roman tant il est dense et multithématique. Disons que c’est une histoire qui commence par la présentation de certains personnages en action, dont l’un, plus grand que nature, s’appelle Papa Davina. Cet homme qui entre en scène dès les premières pages du livre est un charlatan. Il a fondé une secte nouvelle qui se veut œcuménique et qui compte parmi ses sympathisants le Premier ministre en personne. Le récit revient aussi sur l’histoire du Nigeria post-colonial, qui se targue d’être « la nation la plus heureuse du monde » alors qu’elle n’est que la nation « la plus extraordinairement corrompue au monde ». Au milieu de tout ça, émerge le magnifique portrait d’un chirurgien qui vit dans la ville de Jos où il est censé réparer les hommes et femmes mutilés dans des explosions dans le Nord par Boko Haram.
Ces différents fils sont reliés par le scandale de la revente des parties humaines pour en faire des amulettes et autres supports de rituels macabres. Il s’agit d’un véritable business. Tout l’enjeu de l’histoire consiste à découvrir le code secret pour parvenir à pénétrer au cœur de ce cartel immonde de vendeurs d’organes humains, afin de pouvoir le démanteler.
Difficile de ne pas voir dans cette thématique de la vente de parties de corps humains à des fins rituelles la métaphore du pourrissement de la société nigériane dont Soyinka parle ?
Ce motif de la marchandisation du corps humain n’est pas nouveau dans l’œuvre de Soyinka. Dans son Opéra Wonyosi, qui est une réécriture de L’Opéra de quatr’sous de Bertolt Brecht, il y avait déjà une chanson évoquant des hommes impliqués dans le trafic de parties de corps humains pour la fabrication de talismans. Cette pratique que Soyinka dénonçait dès les années 1970 correspond à un mal social réel, rapporté régulièrement par les médias locaux. Mais dans ce roman, le business immonde de ce que l’auteur appelle avec ironie « ressources humaines » est devenu une véritable entreprise, à la tête de laquelle se trouve une société secrète composée de hautes personnalités politiques. On pourrait effectivement lire ce trafic de corps humains comme la métaphore de la déchéance sociale sur laquelle Soyinka a attiré l’attention dès ses premiers ouvrages, notamment dans son roman Les Interprètes. Ce roman s’ouvre sur le retour au pays d’un groupe d’amis au moment de l’indépendance. Idéalistes, ils sont portés par l’ambition de construire un nouveau pays, mais ils verront leur élan coupé par l’immobilisme, la corruption et les divisions qui vont éclater avec la guerre civile. Chroniques narre une histoire similaire, avec ses principaux personnages réunis sous le nom de « Gong of Four », dont l’identité de l’un n’est dévoilée qu’à la fin… Ces hommes se sont connus quand ils étaient étudiants et le roman raconte leurs entrées dans la vie professionnelle, les combats de certains pour s’imposer dans la société où ils sont confrontés à des monstres que sont la corruption, la bureaucratie, le fanatisme religieux et last but not least au cartel spécialisé dans le commerce de restes humains.
En tant que lecteur, on est frappé également par l’épaisseur des personnages, qui sont parfois grotesques, mais souvent très touchants.
L’un de mes personnages préférés dans ce roman, c’est le charlatan Papa Davina. C’est un homme haut en couleurs, présent dès le premier chapitre du livre où on le voit s’acharner sur une disciple, fraîchement convertie, avec dans les coulisses le Premier ministre, son complice. Le roman raconte par le menu détail comment il est devenu l’homme qu’il est, après un passage en prison aux États-Unis pour escroquerie. Sa rencontre avec un prêcheur musulman et un évangéliste l’a conduit à fonder une religion œcuménique, baptisée « Chrislam », mêlant le christianisme et l’islam. Si on est dans la satire et le théâtre du Grand Guignol avec Papa Davina, avec le chirugien Kighare Menka et l’ingénieur Duyole Pitan-Payne, deux protagonistes importants du récit, nous sommes plutôt dans la nuance, l’empathie, l’humanisme, loin de la figure caricaturale et excessive du gourou sectaire. Mais Soyinka excelle dans la construction des personnages démesurés grandguignolesques, comme on a pu voir dans ses pièces de théâtre, notamment dans Baabou Roi, inspirée d’Ubu roi d’Alfred Jarry, ou dans La métamorphose du Frère Jéro, mettant en scène de faux prophètes.
Que peut-on dire de la langue, de l’écriture de Soyinka ?
Ce roman est porté par le style de Soyinka, qui est satirique et ironique, mais aussi poétique. Sa langue est extrêmement riche, avec des jeux de mots, le rythme très particuliers des phrases. Elle m’a fait penser aux Enfants de minuit de Salman Rushdie à cause de sa densité et son foisonnement. Rushdie et Soyinka ont en commun leur imaginaire réellement métissé. Tout comme Rushdie qui tout en puisant son inspiration dans le Bombay de son enfance réinvente dans Les Enfants de minuit une Inde moderne, revue et corrigée par la fiction, de même dans Chroniques on n’est pas dans un monde yorouba, mais dans un Nigeria imaginé, à la fois fictionnel et réel. En réalité, on perçoit un changement depuis ses premiers ouvrages. Pour entrer dans l’univers de son premier roman Les Interprètes par exemple, paru en 1965, il fallait bien connaître la mythologie yorouba pour pouvoir appréhender certains aspects du récit, comme le tableau des dieux yorouba correspondant aux personnages du roman. Chroniques est un texte beaucoup plus accessible, véritablement cosmopolite, irrigué par une multiplicité de références, de Dickens à Bunyan, en passant par le cinéma et quelques petites touches yorubas… La narration part dans tellement de directions ici que si parfois certaines références nous échappent, cela n’empêche pas de suivre le fil général et d’apprécier l’imagination aussi foisonnante que complexe, qui est à l’œuvre dans ces pages.
Une imagination foisonnante sans doute, mais on a l’impression en refermant le livre que cette imagination est nourrie par une vision profondément sombre du monde et de l’avenir de l’humanité. Diriez-vous que Chroniques est un roman pessimiste ?
Je ne dirais pas si Soyinka est pessimiste ou optimiste. Comme nous tous, il est atterré par les dévoiements du pouvoir à tous les niveaux, la corruption politique, les religions se déchirant entre sectes et animées par le goût du gain. Oui, son roman donne à voir avec une certaine gravité la « danse macabre » de l’humanité, les horreurs du monde. Mais sa narration n’est pas que grave. Il y a aussi une légèreté, une énergie, un rire que je qualifierais de « cathartiques ». Je me souviens quand la pièce de Soyinka La mort et l’écuyer du roi a été créée en 1975 mettant en scène des pratiques funèbres traditionnelles jugées barbares par la société moderne, on lui avait reproché d’avoir déterré ce rituel ancien, relançant des polémiques inutiles. L’écrivain avait répondu que cette mise en scène réactivait un rite, non pas dans sa littéralité, mais pour sa fonction symbolique qui permettait de regarder la mort en face et de l’apprivoiser, à travers la poésie, la danse, le chant. Pour moi, son roman relève de la même ambition, celle d’apprivoiser par le rire, l’humour et le récit, les horreurs qui nous entourent.
Chroniques du pays des gens les plus heureux du monde, par Wole Soyinka. Traduit de l’anglais par David Fauquemberg et Fabienne Kanor. 529 pages, 26,90 euros.

(1) Christiane Fioupou est professeure émérite en Etudes anglophones à l’université Toulouse 2. Enseignante pendnat douze ans à l’université de Ouagadougou, Burkina Faso, elle s’est spécialisée dans les littératures du Nigeria : outre la poésie de Nisyi Osundare et de Christopher Okigbo, elle a traduit de l’anglais trois pièces de Wole Soyinka – La route (avec S. Milogo), Baabou roi, Opéra Wonyosi – et son poème Ode humaniste pour Chibok, pour Leah. Elle vient de traduire, avec Adiza Lamien-Ouando, la pièce de Soji Cole, Braises, pour la Maison Antoine Vitez.