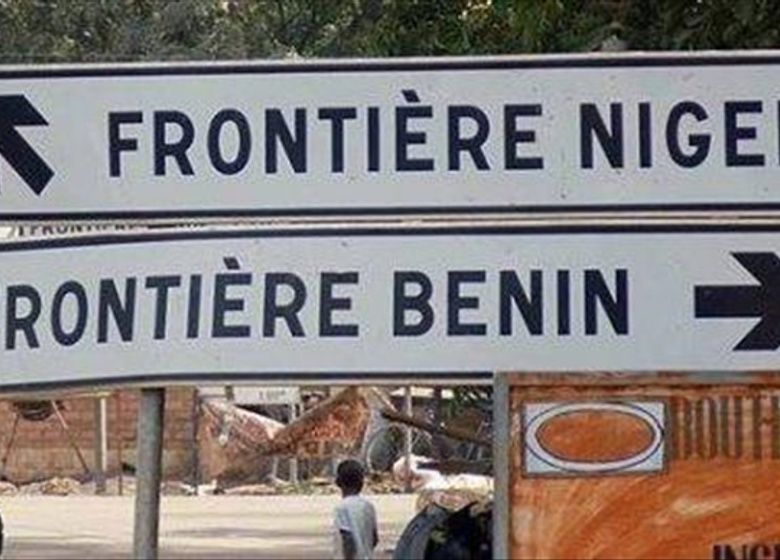Dans une lettre ouverte, le juriste Franck OKE exhorte, avec tout le respect dû à sa haute fonction, le Président de la Cour constitutionnelle, Professeur Dorothé Sossa, « à reconsidérer la position de la Cour constitutionnelle sur une disposition manifestement contraire à la lettre et à l’esprit de notre Constitution ». Il alerte sur « l’inconstitutionnalité de l’article 146 du Code électoral et rappel des responsabilités de la haute juridiction ». Lire-ci dessous l’intégralité de la lettre ouverte.
Lettre ouverte à Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle du Bénin
Objet : Alerte sur l’inconstitutionnalité de l’article 146 du Code électoral et rappel des responsabilités de votre haute juridiction
Monsieur le Président,
Je m’adresse à vous, en tant que citoyen profondément attaché aux valeurs de la démocratie pluraliste et de l’État de droit, pour exprimer ma vive préoccupation concernant la décision DCC 24 – 040 du 14 mars 2024 de la Cour constitutionnelle ayant déclaré conforme à la Constitution le nouveau Code électoral, en particulier son article 146, qui comporte des dispositions gravement problématiques tant du point de vue constitutionnel, démocratique que social.
En effet, l’article 146, alinéa premier, du Code électoral dispose que les partis politiques doivent obtenir au moins 20 % des suffrages exprimés dans chacune des 24 circonscriptions électorales pour pouvoir prétendre à l’attribution des sièges à l’Assemblée nationale.
Une telle exigence, Monsieur le Président, soulève de sérieuses objections de fond :
1. Violation manifeste de l’article 81 de la Constitution et mépris du principe de la hiérarchie des normes
L’article 81, alinéa 3, de la Constitution béninoise est sans équivoque : « La loi fixe le seuil de suffrages minimum à atteindre au plan national pour être éligible à l’attribution des sièges. »
Il ressort clairement de cette disposition que le constituant a souhaité encadrer strictement la faculté du législateur d’instituer un seuil électoral, en le limitant expressément à un seuil national, uniforme et global. Il ne s’agit pas d’une formulation vague ou laissée à l’appréciation politique : le texte fondamental précise la nature géographique du seuil que la loi peut établir.
Or, l’article 146 du Code électoral opère une distorsion grave de cette règle constitutionnelle en instituant un seuil localisé, c’est-à-dire une
exigence de 20 % des suffrages exprimés dans chacune des 24 circonscriptions électorales. Ce basculement du « plan national » au niveau infra-national constitue non seulement un contresens juridique, mais surtout une violation caractérisée du principe de la hiérarchie des normes.
Dans toute architecture juridique conforme à l’État de droit, la norme législative ne saurait contredire la norme constitutionnelle. En l’espèce, le législateur ne s’est pas contenté de préciser ou de compléter une règle constitutionnelle, il en a modifié la portée et détourné l’esprit, en substituant à un seuil national unique une série de seuils locaux cumulés, rendant ainsi inopérante la garantie constitutionnelle de représentation pluraliste.
Ce procédé est juridiquement inacceptable. Il constitue un cas typique de ce que la doctrine qualifie de légalité inconstitutionnelle : une norme régulièrement votée par le Parlement, mais qui outrepasse les limites matérielles que lui impose la Constitution. Autrement dit, l’article 146 du Code électoral est formellement légal, mais substantiellement inconstitutionnel.
Il est donc du devoir de la Cour constitutionnelle, en vertu de l’article 114 de la Constitution, de faire prévaloir la norme supérieure en censurant toute disposition législative qui méconnaît une règle constitutionnelle claire. En validant une disposition aussi frontalement contraire à l’article 81, la Haute juridiction s’expose à un reproche fondamental d’inaction constitutionnelle, voire de renoncement à sa mission régulatrice.
Au-delà du texte, il en va de la crédibilité même du contrôle de constitutionnalité et de la survie du principe de la hiérarchie des normes, sans lequel aucun système juridique ne peut fonctionner durablement.
2. Atteinte grave au principe de représentativité
Imposer un seuil de 20 % dans chacune des 24 circonscriptions électorales revient à ériger une barrière quasi infranchissable pour bon nombre de formations politiques, y compris légitimes et représentatives.
Cette exigence est en décalage total avec la réalité politique et sociologique de notre pays. Elle fausse la représentation nationale, ouvre la voie à un Parlement artificiellement unicolore, et prive une part significative de l’électorat de toute voix au sein de l’Assemblée nationale. C’est là un déficit démocratique majeur, qui porte atteinte au pluralisme et au principe fondamental de l’égalité des suffrages.
3. Un mécanisme de coalition biaisé : un détournement légal du suffrage
L’alinéa 2 de l’article 146 dispose : « Toutefois, pour les partis ayant conclu et déposé à la Commission électorale nationale autonome, préalablement à la tenue du scrutin, un accord de coalition parlementaire, il sera procédé, pour le calcul du seuil prévu à l’alinéa précédent, à la somme des suffrages de ceux ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au plan national. »
Par cette disposition, le législateur instaure une pratique insolite, étrangère aux standards internationaux en matière électorale. Elle crée une inégalité manifeste entre les partis, en permettant à des coalitions artificielles de contourner les exigences du seuil, tandis que des partis autonomes, parfois plus enracinés, se retrouvent marginalisés. Or, faut-il le rappeler, les réformes entreprises depuis bientôt une décennie et jamais achevées proscrivent expressément toute forme d’alliances électorales.
Ce système, loin d’être anodin, insulte l’intelligence collective en institutionnalisant une manœuvre électorale sophistiquée, qui permet à certains de confisquer la représentation nationale sans réelle légitimité démocratique.
C’est une forme de manipulation légale du suffrage, qui ouvre la voie à une recomposition politique fondée sur des alliances opportunistes, au détriment de la transparence, de la loyauté du scrutin et de la volonté populaire.
4 .Risque de régression démocratique, d’instabilité durable et de résurgence de crises graves
Notre pays n’en est pas à sa première alerte. Les années 2019 et 2021 ont été marquées par des crises électorales d’une gravité sans précédent, ayant engendré non seulement une exclusion politique massive, mais aussi des violences meurtrières, des dizaines de morts, des arrestations arbitraires et une fracture profonde entre le peuple et ses institutions.
Ces événements ont laissé des cicatrices durables dans la mémoire collective. La démocratie béninoise, jadis saluée comme un modèle en Afrique, en est sortie fragilisée, contestée, et en perte de crédibilité. C’est dans ce contexte de méfiance et de tension non résolue que l’article 146 s’inscrit.
En validant une disposition aussi rigide et sélective, la Cour crée les conditions d’une récurrence du cycle de défiance, et réactive les mécanismes de verrouillage légal du champ politique qui ont déjà mené notre pays au bord du chaos.
Cet article, en restreignant drastiquement l’accès à la représentation nationale, alimente le sentiment d’exclusion politique chez des pans entiers de la populaton. Il ouvre ainsi la voie à une contestation accrue de la légitimité des futurs scrutins, et pose les germes de crises post-électorales dont nul ne peut prédire l’ampleur ni l’issue.
Cette disposition, aussi technique soit-elle en apparence, porte les germe d’une conflictualité politique profonde, en transformant les élections qui sont un mode de mécanisme de régulation démocratique en outil d’exclusion institutionnelle.
Il ne s’agit donc pas seulement d’une maladresse juridique ou d’un choix discutable de seuil : il s’agit d’un risque systémique, d’une régression démocratique assumée, aux conséquences potentiellement dévastatrices pour la stabilité de la République.
L’expérience béninoise récente (et celle d’autres pays de la sous-région) démontre qu’un processus électoral perçu comme injuste ou verrouillé peut devenir le point de départ de tensions graves, voire de basculements irréversibles.
C’est ce risque que votre juridiction est appelée à prévenir, non pas après coup, mais en amont, par un contrôle de constitutionnalité rigoureux, exigeant, et orienté vers la préservation de la paix, de l’inclusion politique et de la démocratie pluraliste.
5. Une disposition tendancieuse et dangereuse pour l’avenir démocratique
Loin d’être une simple erreur technique, l’article 146 est une disposition tendancieuse, qui peut être instrumentalisée pour verrouiller l’espace politique, instaurer une hégémonie institutionnalisée, et détourner la volonté populaire exprimée dans les urnes.
La Cour aurait dû s’y opposer fermement, conformément à l’article 114 de la Constitution, qui lui confère la mission de garantir le respect du texte fondamental, de préserver l’équilibre institutionnel et de protéger les droits politiques des citoyens.
6. Un appel au souvenir, à la cohérence et à la responsabilité
Monsieur le Président, permettez-moi, enfin, de faire appel à votre mémoire, à votre exigence intellectuelle, mais aussi à votre responsabilité historique et institutionnelle.
Je ne m’adresse pas seulement ici au Président de la Cour constitutionnelle, mais aussi à mon ancien professeur de droit, celui qui m’a initié, en première année, à l’introduction au droit, et en deuxième année, au droit des obligations, avec rigueur, clarté et passion.
C’est de vous que j’ai appris, comme tant d’autres étudiants de la Faculté de droit, que le droit ne se limite pas à des textes, mais qu’il est d’abord un outil de justice, de raison critique, et de protection contre l’arbitraire. Vous nous avez enseigné que la norme n’a de sens que si elle respecte l’humain, la liberté, et la cohérence du système juridique dans son ensemble.
Aujourd’hui, ces principes que vous avez portés en chaire trouvent une résonance aiguë dans le rôle que vous incarnez à la tête de l’institution gardienne de notre Constitution.
Vous le savez mieux que quiconque : il n’y a pas de droit véritable sans courage, ni de juge constitutionnel digne de ce nom sans vigilance démocratique. Le juge constitutionnel ne peut se retrancher derrière une lecture strictement formelle des textes. Il est tenu d’en évaluer la finalité, la cohérence, et surtout les conséquences profondes sur les droits et les libertés des citoyens.
Ce moment vous appelle à être fidèle à vos propres enseignements, à vos propres convictions, et à l’héritage de la Conférence des forces vives de la Nation de 1990, dont l’esprit continue d’inspirer notre pacte républicain.
L’histoire retiendra les choix faits en conscience, dans les moments de tension et de bascule. Elle retiendra les silences, tout autant que les prises de position courageuses. Elle retiendra surtout si les garants de la Constitution ont su, au moment critique, se hisser au-dessus des contingences politiques pour défendre la République.
En conclusion
Je vous exhorte, avec tout le respect dû à votre haute fonction, à reconsidérer la position de la Cour constitutionnelle sur cette disposition manifestement contraire à la lettre et à l’esprit de notre Constitution.
Le peuple béninois, héritier de la Conférence des forces vives de la Nation de février 1990, a placé en votre institution une confiance historique. Il attend qu’elle reste fidèle à cet héritage, celui de la transparence, de la justice, de la pluralité, et de l’équité démocratique.
Veuillez croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma très haute considération.
Franck OKE
Juriste