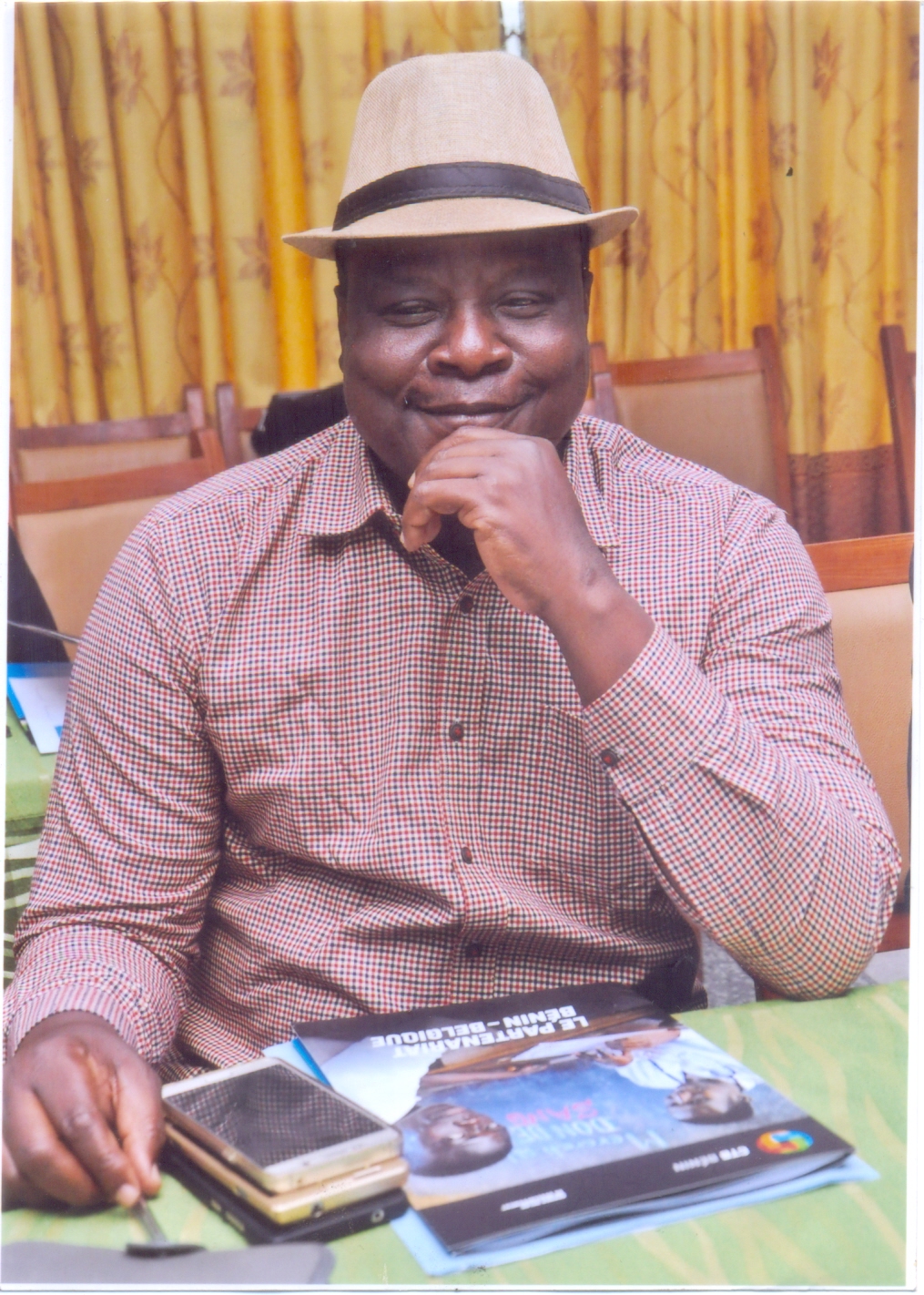« Il faut le dire haut et fort : ce que l’on nous présente aujourd’hui comme une réforme électorale est en réalité une opération de camouflage politique, une manœuvre cynique visant à verrouiller le jeu démocratique sous des apparences de modernisation.
On ne peut pas interdire formellement les alliances électorales, tout en autorisant que des partis politiques conjuguent leurs efforts pour additionner leurs scores à l’issue d’un scrutin, dans le seul but de franchir artificiellement le seuil de représentativité requis pour l’attribution des sièges.( Cf. Article 146 nouveau de la loi No.2024 – 13 du 15 mars 2024 modifiant et complétant la loi No 2019 – 43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin.).
C’est non seulement incohérent, mais fondamentalement malhonnête.
Cette disposition ne vise ni à renforcer la transparence, ni à clarifier le paysage politique. Au contraire, elle crée une illusion de pluralisme, tout en permettant à certains acteurs de contourner les règles qu’ils prétendent défendre.
Une imposture démocratique
Appeler cela une « réforme » relève de l’imposture. Il s’agit, en réalité, d’une opération de contournement, une tactique dissimulée qui profite à ceux qui ont les moyens de s’entendre en coulisses, tout en interdisant aux autres de le faire à visage découvert, dans un cadre d’alliance assumée et assumable.
Il y a là une distorsion du principe d’égalité politique. Interdire les alliances formelles mais permettre une addition informelle des scores, c’est refuser aux citoyens la lisibilité de l’offre politique. C’est refuser à l’électorat la possibilité de savoir qui s’allie à qui, sur quelles bases, et dans quelle perspective.
Une anomalie sans précédent
Soyons clairs : cette formule hybride n’existe nulle part ailleurs dans le monde démocratique. Aucun modèle électoral sérieux ne tolère une telle incohérence entre l’interdiction des alliances et l’agrégation post-électorale des résultats.
Elle ne repose sur aucun cadre doctrinal, aucune jurisprudence électorale internationale, et ne répond à aucun impératif de stabilité institutionnelle. C’est une construction sur-mesure, au service d’intérêts conjoncturels, qui fragilise durablement la crédibilité des institutions et la confiance des électeurs.
Pour une réforme honnête, cohérente et démocratique
Une véritable réforme électorale ne peut pas être une usine à gaz destinée à neutraliser certains et favoriser d’autres. Elle doit être guidée par la clarté, la cohérence et l’équité. Si l’objectif est de limiter la fragmentation, alors il faut ouvrir un débat transparent sur les alliances, les coalitions et les seuils. Mais on ne peut pas, dans le même mouvement, prohiber et tolérer, interdire et encourager, disqualifier et autoriser.
Car ce double discours mine la démocratie. Et la démocratie ne s’accommode pas de manœuvres opaques.
Enfin pour une réforme plus conforme à ses objectifs
Dans l’esprit de la réforme engagée, qui vise principalement à réduire la fragmentation du paysage politique, il est essentiel que le législateur mesure pleinement les implications de cette orientation.
Il convient de rappeler que le choix du mode de scrutin constitue, dans toute réforme électorale, la variable la plus déterminante. C’est lui qui structure le système représentatif, conditionne les dynamiques partisanes et influe directement sur la stabilité des institutions. En ce sens, il ne saurait être traité comme un simple paramètre technique.
Il serait dès lors incohérent d’ériger la lutte contre la dispersion partisane en principe directeur, tout en conservant un mode de scrutin proportionnel, qui, par nature, tend à favoriser la multiplication des forces politiques.
C’est pourquoi nous recommandons l’adoption d’un mode de scrutin majoritaire, plus en adéquation avec les finalités poursuivies. Compte tenu de l’organisation actuelle du système électoral, fondée sur 24 circonscriptions électorales, pour 109 sièges, le scrutin majoritaire de liste nous semble constituer l’option la plus appropriée.
Telle est, en toute modestie, la contribution que nous souhaitons apporter au débat ».
D’après une analyse de Franck OKE
A lire aussi: